
La mondialisation et la fiscalité ( Par Dr Mamadou Aliou BAH)
La mondialisation (ou globalization pour les anglo-saxons) vient du latin « mundus », univers. Elle désigne le processus d'ouverture de toutes les économies nationales sur un marché devenu planétaire. La mondialisation est favorisée par l'interdépendance entre les hommes, la déréglementation, la libéralisation des échanges, la délocalisation de l'activité, la fluidité des mouvements financiers, le développement des moyens de transport, de télécommunication. Les entreprises multinationales déterminent leurs choix stratégiques (localisation, approvisionnements, financement, circuits de commercialisation, recrutements, débouchés, investissements...) à l'échelle mondiale, en comparant les avantages et inconvénients que leur procurent les différentes solutions nationales possibles. Contrairement à certains discours contemporains, la mondialisation n’est pas une invention de la fin du 20ème siècle. C’est un processus de longue durée qui remonte loin dans le temps puisqu’il existait déjà un marché mondial des épices au Moyen-âge, un marché mondial des métaux précieux dès le XVe siècle à la suite des Grandes Découvertes, un marché mondial des tissus de coton venus de l’Inde au XVIe siècle, sans oublier le « commerce triangulaire » entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique dans lequel s’intègre la traite des Noirs. De plus, l’ingérence des États occidentaux dans le continent pour le contrôle des ressources naturelles s’intègre aussi dans un processus de mondialisation des échanges. On peut faire commencer la mondialisation aux grandes expéditions maritimes des XVe et XVIe siècles (en particulier au premier tour du monde réalisé par Ferdinand Magellan en 1522) qui ont permis la création des empires coloniaux. Le terme de mondialisation est apparu, en français, en 1964 dans le cadre de travaux économiques et géopolitiques pour désigner l'extension des marchés industriels au niveau des blocs géopolitiques, au moment de la Guerre froide. Il s'est généralisé dans les années 1990, à partir de thèses du philosophe Marshall McLuhan sur l'émergence d'un « village global », mais surtout par le fait des mouvements antimondialistes et altermondialistes qui ont voulu attirer l'attention du public sur l'ampleur du phénomène. Depuis, il se dit que « la chute du mur de Berlin le 10 Novembre 1989 et la fin du communisme en Europe de l’Est, ont donné un nouvel élan à l’économie mondiale avec le triomphe de l’idéologie capitaliste ». Ce nouvel élan s’est traduit dans les faits par le développement de nouvelles théories économiques basées sur la suprématie du marché. Pendant qu’on croyait que la fin du communisme, pour paraphraser Alain Minc, allait favoriser l’émergence de la démocratie, c’est plutôt la loi du marché qui s’est imposée à tout le monde, même dans les derniers bastions de l’idéologie marxiste-léniniste que sont la Chine populaire, le Vietnam et Cuba. C’est ce triomphe du marché qui est qualifié de mondialisation de l’économie. En réalité, la loi du marché n’est qu’un retour en arrière au regard des grands événements qui ont marqué l’économie mondiale. La mondialisation bouscule les frontières. Elle accroît les interdépendances. Sa mise en place s’accompagne d’une redistribution des activités, avec des groupes de perdants et de gagnants. Elle génère des flux migratoires qui ont déjà profondément transformé tous les pays du Nord. Dans les faits, l’économie est largement mondialisée. En revanche, au plan institutionnel, on en est resté au règne absolu de l’État-nation. Les instances internationales (ONU, FMI, OMC, etc.) restent entièrement sous le contrôle des États. Le terme de mondialisation est surtout utilisé dans le domaine économique, mais celle-ci touche à toutes les activités humaines : industrie, services, commerce, politique, social. Elle concerne aussi la communication et les échanges entre tous les individus de la Terre devenue "village planétaire" et entre les différentes cultures. Il devient alors très difficile de fonctionner dans un marché uniquement national. Durant les quarante dernières années, le faible développement de la production agricole dans la CEDEAO s’est principalement fait par un accroissement des superficies cultivées et non par une intensification. Aussi, la consommation en Afrique de l’Ouest est-elle l’une des plus faibles au monde : seuls 9 kg/ha/an de nutriments sont appliqués dans l’espace CEDEAO contre une consommation moyenne mondiale de 100.8 kg/ha/an en 2002. Les fiscalités nationales ne peuvent ignorer le phénomène de la mondialisation, et on peut même dire que le processus de mondialisation a suscité un large débat au sein de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à cause notamment d’une tendance presque spontanée à la convergence des taux d’imposition dans le nouveau contexte qu’engendre la globalisation de l’économie. Au fond, la mondialisation est tout, sauf un système éthique qui vise à protéger les intérêts de chacun et de tous, des plus riches et des plus pauvres, des faibles et des forts. La mondialisation est avant tout une arme entre les mains d’un système prédateur. Ainsi, selon Jacques Adda, « parler de mondialisation, c’est évoquer l’emprise d’un système économique, le capitalisme, sur l’espace mondial ». Sur le plan fiscal, cette mondialisation a largement profité aux pays développés. C’est pourquoi Sophie Baziadoly peut en célébrer les prouesses en ces termes : « Dans un contexte de mondialisation se caractérisant par une interdépendance accrue des économies étatiques, il serait absurde de considérer que la fiscalité puisse se concevoir dans un cadre purement national. La mondialisation, c’est-à-dire l’internationalisation des échanges commerciaux, financiers et humains mais aussi et surtout la construction européenne ont eu un impact sur la liberté de décision des États membres de l’Union européenne et des pays industrialisés de l’Organisation de Développement et de Coopération Économique (OCDE) en matière fiscale, bien que la fiscalité constitue encore un domaine de souveraineté nationale ». Nous soutenons la première partie des propos de Sophie Baziadoly sans équivoque : l’âge de la souveraineté absolue en matière fiscale est révolu, chaque État est redevable à un autre de sa prospérité et de son équilibre économique. Mais nous ne suivons pas Sophie Baziadoly lorsqu’elle célèbre l’âge d’or de la mondialisation en partant des effets bénéfiques de l’Union européenne : cela montre qu’elle ne tient pas compte des coûts pour les périphéries, notamment certains États africains arrimés aux économies nationales européennes pour leur politique économique et fiscale. Par exemple, l’émergence d’un cadre européen a conduit à une délocalisation à Bruxelles des stratégies d’aide au développement, diminuant ainsi la part de l’intervention directe de certains États comme la France ou le Royaume-Uni dans les politiques de développement. Or la trop forte tendance au libéralisme, caractéristique des politiques publiques européennes, implique un délaissement des pratiques politiques et humaines au profit des bénéfices immédiats et économiques. De ce point de vue, l’émergence de l’Europe des 27 renforce une intégration régionale aux dépens des effets bénéfiques d’une coopération bilatérale traditionnelle entre les États-nations européens pris séparément et ceux du Sud. Des mouvements sociaux dénoncent la mondialisation (les altermondialistes), en utilisant Internet, et des replis identitaires se manifestent. Les réseaux de communication, comme les réseaux de financement rentre en résonnance avec des réseaux de mafias voire de terroristes. Pour revenir aux effets de la mondialisation sur les politiques publiques, disons que la crise financière mondiale actuelle est susceptible d’entraîner des répercussions sur les baisses d’impôts. Les modèles nationaux semblent plier devant les effets dévastateurs de cette crise, qui pèse dramatiquement sur la philosophie et les critères des choix qui forgent les politiques nationales de la fiscalité. Ailleurs, comme dans l’espace de la CEDEAO, cela s’est ressenti sur les politiques fiscales. Avec, en prime, une réelle difficulté structurelle à définir clairement les populations imposables. Il convient d’exposer les dispositions relatives à la fiscalité de la CEDEAO. Et nous présenterons la gouvernance mondiale et la sémantique locale. Dr MAMADOU ALIOU BAH, Inspecteur Principal des Impôts
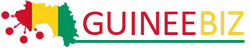


Commentaires