
Les sanctions fiscales et les infractions pénales ( Par Dr Mamadou Aliou BAH )
Les sanctions fiscales sont indiquées dans les dispositions fiscales du CGI : les articles 452,453, 469. L'Administration fiscale applique des sanctions fiscales aux manquements des obligations du contribuable qui contrevient à la réglementation. Il s'agit soit des intérêts de retard de l'ordre de 1,5% à 50% des droits mis à la charge du contribuable, soit des majorations de l'ordre de 30% à 150% selon qu'il s'agit de la bonne foi, mauvaise foi ou fraude, lesdites majorations venant en ajout aux intérêts de retard. Pour les infractions pénales, il s’agit des peines applicables aux personnes physiques et de la responsabilité des personnes morales : les détournements, les blanchements, et la concussion. « La sanction fiscale est un droit de sanctionner » selon le professeur Thierry LAMBERT. Mais aussi c’est un droit partagé dans le sens de l’intervention de l’administration fiscale et le juge fiscal dans un contentieux fiscal. Lorsque, le rapport entre l’administration fiscale et le contribuable ne s’améliore pas à tel point que le juge civil de droit fiscal intervienne, elle devient une solution partagée entre l’administration fiscale et le juge répressif. Le contribuable est redevable d'un intérêt de retard de 0,40% par mois. En Guinée, les sanctions fiscales ont trait à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt, mais toujours est-il que l'Administration fiscale se fonde sur des notions vagues de bonne foi, mauvaise foi ou manœuvres frauduleuses. L’article 449 stipule : « les infractions aux règlements qui fixent l’assiette, la quotité et le mode de perception des taxes indirectes intérieures perçues en Guinée peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires ». Les sanctions applicables en matière fiscale se subdivisent en deux grandes catégories : les sanctions fiscales dénommées sanctions administratives et les sanctions pénales. Les sanctions fiscales sont les sanctions pécuniaires appliquées par l’administration en vertu de la loi sous le contrôle du juge. LES SANCTIONS DE FRAUDE FISCALE Les sanctions de fraude fiscale sont toujours établies par les agents de la Direction Générale des Impôts (DGI). Elles correspondent à des infractions le plus souvent relevées par eux. On range dans la catégorie des sanctions de fraude fiscale : les majorations de droits, les intérêts de retard et les amendes. Ces sanctions administratives connaissent une particularité car elles peuvent faire l’objet de réductions. Il y’a les manœuvres frauduleuses qui ne sont pas définies par la loi fiscale mais par l’administration fiscale. -L’APPLICATION DES SANCTIONS DE FRAUDE FISCALE Les sanctions administratives ou fiscales ont à la fois le caractère d’une indemnité allouée au trésor en réparation d’un préjudice financier, et le caractère d’une véritable peine qui en cas de mauvaise foi de la part des contribuables peut être aggravée. Il s’agit entre autres les infractions fiscales et les Intérêts de retard. A) -LES INFRACTIONS EN MATIERE FISCALE Elles forment la catégorie la plus fréquemment mise en œuvre, puisqu’elles sont attachées aux principaux impôts concernant les particuliers et les entreprises. Les infractions aux règlements qui fixent l’assiette, la quotité et le mode de perception des taxes indirectes intérieures perçues en Guinée peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires (Article 449). Les infractions sont prouvées par tous modes de droits communs ou constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire ou par des fonctionnaires ou agents de l’administration assermentés, chargés de l’application des taxes ou de contrôle. Le CGI réserve un chapitre aux différentes pénalités susceptibles de frapper les contribuables indélicats. Cette expression recouvre d’une part les sanctions édictées par l’administration fiscale ou par le juge pénal qui visent à punir les comportements répréhensibles, et d’autre part les intérêts retard, que le contribuable peut être conduit à acquitter afin d’indemniser l’Etat pour le préjudice subi du fait de la déclaration ou du paiement tardif de l’impôt. Les sanctions et l’intérêt de retard ne sont pas sans lien. Outre le fait que les intérêts de retard viennent généralement s’ajouter aux sanctions, ces deux formes de pénalités connaissent plusieurs éléments de régime commun. En premier lieu, l’administration dispose d’importantes marges de libertés pour alléger leur montant, notamment dans le cadre de ses pouvoirs de transaction, afin de faciliter le recouvrement de l’impôt. C’est ainsi que, bien souvent, des négociations s’établissent sur l’ensemble de ces pénalités, au terme d’un contrôle. Autre point commun, qui tient aux règles de fond du droit fiscal : le montant des sanctions comme celui des intérêts de retard dus par les entreprises ne sont pas déductibles de leur résultat imposable. -LES INTERETS DE RETARD EN MATIERE FISCALE Les dispositions législatives relatives aux sanctions susceptibles d’être édictées par l’administration fiscale sont d’une redoutable complexité. Cette complexité tient à la diversité des sanctions prévues par les textes, et à l’empilement de dispositions qui, pour certaines, intéressent l’ensemble des impositions, alors que d’autres ne concernent que certains impôts bien particuliers, ou encore certains comportements. Pour que les retardataires ne soient pas avantagés par rapport aux contribuables ayant rempli leurs obligations dans les temps, les impôts payés au-delà légaux sont en principe assortis d’un intérêt de retard. Cet intérêt ne constitue pas une sanction mais seulement « le prix du temps » : il vise simplement à réparer le préjudice causé à l’Etat du fait du paiement tardif de l’impôt ou, autrement dit, à rémunérer le « crédit forcé ». Il convient de préciser que la bonne foi est toujours présumée et perçue en fonction de la personne (vu la cause) et en fonction de l'acte (vu l'effet). Par ailleurs l'Administration exclut la bonne foi quand le contribuable était au courant des faits qui ont provoqué le redressement. C'est notamment le cas quand sa déclaration ne correspond pas aux documents comptables en sa possession ou aux renseignements fournis par les banques, clients ou fournisseurs de l'intéressé. A contrario, ce qui est délibérément fausses relèves de la mauvaise foi. La mauvaise foi est perceptible lorsque l'erreur ou l'insuffisance du contribuable est volontaire, sans qu'il se soit livré à des manœuvres frauduleuses. La mauvaise foi est plus facilement admise quand le contribuable, personne physique ou morale, oublie de déclarer une bonne partie de ses revenus ou de ses bénéfices. La sanction est la majoration de 100% pour les déclarations de paiement produites de mauvaise foi en plus des intérêts de retard. En Guinée, en cas de mauvaise foi, le contribuable doit acquitter une majoration de 100% en plus des intérêts de retard. Par ailleurs la mauvaise foi ne peut concerner qu'une partie des insuffisances ou omissions constatées et la majoration ne s'applique alors qu'en proportion de cette partie. La nature des erreurs entre aussi en ligne de compte dans la détermination de la mauvaise foi. Elle est facilement établie lorsque des dépenses manifestement personnelles sont passées en frais professionnels, quand il y a cumul d'allocations forfaitaires et de remboursements de frais, etc. De même, il est difficile de plaider l'innocence quand on se trompe, de façon régulière, répétée et toujours à son avantage. Ainsi on peut associer dans certains cas la mauvaise foi à l'erreur. La mauvaise foi est un terme employé en droit général pour désigner « un comportement incorrect qui participe, à des degrés divers, de l'insincérité, de l'infidélité, voire de la déloyauté. Conduit toujours à un régime de faveur qui se marque, selon les cas, par l'aggravation de la responsabilité, la perte d'un bénéfice ou l'amoindrissement d'un droit ». La mauvaise foi est également pénalement considérée comme une intention, « Conscience éclairée et volonté libre de transgresser les prescriptions de la loi pénale. » Il en va autrement pour ce qui est de la manœuvre frauduleuse dans la mesure où elle vise à tromper, à induire expressément en erreur une personne. En observant la psychologie du contribuable, le juge fiscal est à même de dire que le défaut de paiement de la patente pour le cas visé ici est délibéré et matériellement caractérisé par la récidive. Pour ce faire, l'infraction d'absence ou de défaut de déclaration ici sera sanctionnée par la taxation d'office et la majoration de 150% appliquée après une mise en demeure de déclarer. En revanche, lorsqu'il est simplement question d'absence de déclaration sans récidive, le contribuable est soumis à la taxation d'office et à une majoration de 100% du montant de la patente due. En droit d'enregistrement, la mutation de jouissance d'immeuble dans laquelle les parties au contrat déclarent un prix autre à la place du prix réel de l'immeuble constitue soit une simulation soit une dissimulation. Dans le cas ainsi présenté, l'inspecteur sanctionne le contribuable par un versement en plus des droits exigés par le CGI, d'un montant égal à 100% des droits en principal du fait de la dissimulation avec existence d'une contre lettre (les articles 318, 323 à 329 sur la sanction de l'omission, l'insuffisance et la dissimulation en droit d'enregistrement.). Les Infractions pénales Les peines applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales, elles sont coupables des infractions prévues au Code pénal et encourent également les peines suivantes : -Les détournements Il s’agit de l’abus de confiance qui est le fait par une personne de détourner ou de dissiper, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amendé de 500 000 à 25 000 000 de francs guinéens. -Les blanchiments D’après l’article 499, « le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment sont punies d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l’une de ces deux peines seulement ». - La concussion C’est l’article 656 du Code pénal guinéen. La concussion peut toucher 80% des fonctionnaires guinéens des impôts. Elle est définie comme le fait pour un agent public de percevoir ou de recevoir des sommes qu’il sait ne pas être dues par celui ou ceux qui les lui ont versées. Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs de droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui ont reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, impôts, taxes, contributions ou derniers ou pour salaire ou traitement ce qu’ils savent n’être pas dû où excéder ce qui était dû, sont punis les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 500 000 francs guinéens à 2 500 000 francs guinéens. En résume, les obligations et contraintes préviennent l’arbitraire et participent à l’équilibre entre l’intérêt général la juste perception de l’impôt et les droits des contribuables. Par ailleurs, pour assurer cet équilibre, le contribuable dispose des prérogatives visant à vérifier leur légalité. Tout usage irrégulier, illégal ou abusif des pouvoirs d’investigation vicie l’imposition établie grâce à l’exercice de ceux-ci. Si les preuves illégales par exemple, résultant de l’exercice de pouvoirs d’investigation en dehors des délais légaux ; entraînent l’annulation des cotisations pour violation de la loi, il n’en va pas nécessairement de même pour les preuves obtenues illégalement : dans ce dernier cas, il s’agira de pondérer les intérêts de l’État percepteur et les droits des contribuables. Dr MAMADOU ALIOU BAH, Inspecteur Principal des Impôts.
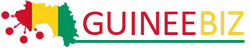


Commentaires